Date : 5 novembre 2024
Lieu : Campus Condorcet, Aubervilliers
Date limite pour soumettre une proposition : 30 juin 2024
De la matérialité des sources.
Journée d’études jeunes chercheurs 2024 du Centre Jean Mabillon – École nationale des Chartes.
La source constitue l’élément de base de la recherche historique, que le scientifique cherche le mieux possible à appréhender par son esprit critique. Mais ces sources, ne peut-on pas également les approcher matériellement ? La matérialité des sources se révèle immédiatement très variée et il serait difficile d’en dresser une liste exhaustive, car en plus d’avoir évolué au cours du temps, les supports ont connu à chaque époque une riche diversité. Ainsi, pour prendre l’un des supports le plus commun aujourd’hui qu’est le livre, on constate qu’après avoir été volumen de papyrus, celui-ci est devenu codex, d’abord en parchemin, puis en papier, se démultipliant ensuite grâce à l’imprimerie à caractères mobiles jusqu’à devenir un objet de consommation à l’ère du livre de poche. L’exemple du livre nous montre donc que la variation du support concerne non seulement le matériau, mais aussi le format. Mais ces variations sont également partagées dans les autres champs de la production écrite : littérature grise d’une part avec ses procès-verbaux, chartes, registres, mais aussi les productions éphémères, des journaux aux affiches en passant par les tracts, sans oublier les formes épigraphiques, des ostraca grecs aux tablettes de cire, jusqu’aux pierres gravées.
La question du support mérite néanmoins d’être élargie plus encore et nous invite à envisager également les autres moyens employés pour consigner d’autres informations que simple la parole écrite : l’image, qui existe depuis les peintures rupestres préhistoriques, s’est perpétuée jusqu’à la photographie et le cinéma, de même que les enregistrements sonores sont développés pour couvrir un champ allant de la musique aux archives orales. L’histoire du temps présent nous amène enfin à appréhender l’omniprésence de l’information, à travers les réseaux sociaux et internet. Une quantité indénombrable de paramètres entre donc en conversation pour la composition du support : le matériau et son format certes, mais aussi sa taille, son poids, la technologie qu’il emprunte, ses limites, sa durabilité, son coût, sa solennité, sa fragilité, sa solidité, sa qualité, son accessibilité, la quantité de production permise. Autant de composantes qui peuvent être interrogées et révélatrices d’informations précieuses.
Au regard de ce bref florilège de sources, il apparaît nettement que le support des sources est un sujet d’étude historique en soi. La matérialité des documents est à la fois un indicateur temporel, géographique et culturel : en somme, une source à part entière, indépendamment du contenu, un objet archéologique. Bien que l’approche soit matérielle, elle implique donc bien une appréhension par l’esprit critique. Jacques le Goff s’exprimait en ces termes :
« Le document n’est jamais innocent. Il est le résultat avant tout d’un montage, conscient ou inconscient, de l’histoire, de la société qui l’a produit, mais aussi des époques successives pendant lesquelles il a continué à vivre, peut-être oublié, pendant lesquelles il a continué à être manipulé, peut-être en silence. Le document est une chose qui reste, qui dure et le témoignage, l’enseignement qu’il porte doivent être avant tout analysés en démystifiant leur signification apparente. Le document est monument. Il est le résultat de l’effort des sociétés historiques pour imposer –volontairement ou involontairement– telle image d’elles-mêmes au futur. Il n’y a pas, à la limite de document-vérité. Tout document est mensonge.1 »
Ainsi, le choix même du support n’est pas innocent, car quelle que soit l’époque, les supports à disposition pour conserver une information ont toujours été multiples. Le choix n’en est pas pour autant aléatoire et différents facteurs interviennent dans la sélection du support : les impératifs économiques, la dimension solennelle, la commodité, la limite selon les matériaux à disposition, mais aussi selon le type d’information conservée (écrit, son, image). Le choix d’un unique support reste parfois cependant impossible. De nombreux documents contemporains sont en effet multimédias : de très nombreux manuels de langue pour enrichir l’étude par la pratique orale sont par exemple accompagnés d’un CD-Rom. Une dynamique se fait jour néanmoins parmi ces paramètres : les enjeux matériels sont bien souvent commandés par le fonds intellectuel. Le contenu peut commander le contenant, non sans parfois une certaine réciprocité.
Toutes ces motivations gardaient néanmoins en ligne de mire l’utilisation du document dans un avenir immédiat, le défi se pose donc au conservateur de faire face à des supports dont la production n’est pas toujours conçue pour le temps long. Par exemple, du fait d’un climat inadapté, très peu de papyrii mérovingiens nous sont parvenus, tandis que depuis près d’un siècle, les conservateurs de bibliothèque doivent faire face à des journaux dont le papier de mauvaise qualité, en plus de jaunir, se fragilise très rapidement. Plus délicats encore, les plus anciens films conservés par les cinémathèques sont très souvent des pellicules en nitrate de cellulose, support particulièrement instable qui présente un grave risque d’incendie.
On remarque donc que les supports fluctuent au gré des époques. Et les informations, en vue de pérennisation, doivent souvent être recopiées de l’un à l’autre. Qu’il s’agisse des copies médiévales de chartes originales au sein de cartulaires, d’éditions contemporaines de documents anciens, de l’adaptation iconographique de scènes littéraires ou religieuses, ou encore de l’édition numérique de textes anciens, on observe la même envie de conserver un maximum de l’information textuelle, mais aussi un certain souci de la mise en page originale. Toutefois, il est illusoire de penser qu’il est possible de tout retranscrire, une transition est souvent coûteuse et synonyme de choix.
Ouvertures
Dans ce contexte, nous accueillons les propositions qui pourront explorer le thème du support. Les enjeux de cette journée d’études tournent autour de quatre axes principaux : 1) Les problématiques
de la conservation et de la restauration ; 2) Les enjeux de la copie et du transfert d’un support à un autre ; 3) La question de l’unique et du multiple ; 4) (R)évolution : l’essor du digital.
Voici une liste non-exhaustive de problématiques abordables pour chacun d’entre eux :
1) Les problématiques de la conservation et de la restauration
Problématiques de la conservation des supports, de l’Antiquité à nos jours. Entretien des supports : travaux de reliure, restauration des enluminures,… ; Les supports abîmés : techniques de restaurations, nouvelles technologies.
2) Les enjeux de la copie et du transfert d’un support à un autre
Interactions réciproques entre contenu et contenant, des enjeux pratiques aux enjeux esthétiques ; La création d’une copie quels motifs, selon quels procédés, avec quels résultats ? Quelles différences entre des copies sur un même support et le passage d’un support à l’autre ? ; L’intermédialité et le passage d’un support à un autre : quels enjeux, quelles conséquences ?
3) La question de l’unique et du multiple
Un seul support pour plusieurs documents – tablettes de cire, palimpsestes, google docs, recueils factices, fichier xml ; Plusieurs supports pour un seul document (copies de films positives, copies lavandes, négatifs de films, internégatifs ou encore versions numériques DCP. . . )
4) (R)évolution : l’essor du digital
La révolution du numérique : récupérer, trier et écarter les informations ; Avantages et désavantages dans la conservation des documents ; L’évolution d’un média et les changements ou non qu’il apporte aux oeuvres, comme par exemple le passage du cinéma sur pellicule au cinéma numérique ; Le multimédia, enjeux de production et de conservation.
Comité d’organisation
Mathieu Aymon, Célia De Saint Riquier, Martina Lenzi, Noé Leroy (doctorants du Centre Jean Mabillon).
Cyril Durain, Clémentine Kruk (archivistes paléographes de l’École Nationale des Chartes).
Comité scientifique
Christophe Gauthier (Professeur d’histoire du livre et des médias, École Nationale des Chartes PSL’ directeur du Centre Jean-Mabillon, ea 3624 conservateur des bibliothèques)
Yann Sordet (Conservateur général des bibliothèques, directeur des bibliothèques Mazarine et de l’Institut de France)
Nicolas Perreaux (Chargé de recherches CNRS, UMR 8589 LAMOP université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Charlotte Denoël (Chargée de cours École Nationale des Chartes PSL, maîtresse de conférence
Date et lieu
Campus Condorcet, Aubervilliers, 5 novembre 2024.
Modalités de réponse
Cette journée d’études s’adresse aux doctorant.e.s ou équivalent, étudiant.e.s en master, jeunes chercheur.se.s post-doctoraux, ainsi qu’aux jeunes professionnel.le.s de la conservation du patrimoine.
Toutes les propositions de communication sont attendues avant le 30 juin 2024, à midi. Elles sont attendues en langue française ou anglaise sous la forme d’un texte constitué de 500 mots maximum (titre et résumé), accompagné d’une bibliographie indicative et d’une courte présentation du candidat (âge, ville de résidence, statut, situation institutionnelle, domaine de recherche). Le format attendu est le format .pdf. Merci de les envoyer à l’adresse suivante : journeesCJM@chartes.psl.eu
Une réponse sera donnée aux intéressé.e.s avant le 15 juillet 2024. Un résumé ponctuel ou le discours intégral, accompagné par la bibliographie relative, sera demandé aux intervenant.e.s avant le 5 novembre. Chaque communication aura une durée maximale de 20 minutes. Les déplacements et les hébergements seront à la charge des intéressé.e.s. Il est prévu que cette journée d’études donne lieu à une publication en ligne.
Source : AJCH

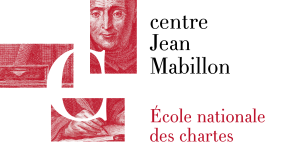






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.