À l’heure où s’intensifient les débats sur le renversement de la courbe des âges en Europe – que l’on pourrait, non sans une pointe d’ironie, qualifier de « vieillissante » – et, plus largement, dans le monde occidental, les notions de « jeunesse » et de « vieillesse », envisagées comme catégories sociales, ressurgissent avec force. Ces catégories, dont on peinera pourtant à trouver une définition consensuelle, sont loin d’être neutres. Elles se trouvent au cœur de débats traversés par des problématiques majeures :
L’organisation du travail : recul des âges de départ à la retraite ; accélération de l’entrée des plus jeunes sur un marché du travail toujours plus sous tension.
Le délitement des solidarités : fracture numérique qui isole les plus âgé·es ; mauvaise gestion des maisons de repos pendant la pandémie de Covid-19.
Les dynamiques migratoires, enfin, instrumentalisées par des rhétoriques racistes et complotistes autour du « grand remplacement » : une Europe décrite comme incapable de perpétuer sa « civilisation » parce que vieillissante et prétendument menacée par une Afrique forte d’une jeunesse innombrable.
Une expression a fait florès et occupe désormais une place prépondérante dans l’espace public : le clash de générations. Derrière ces discours persiste une question : parlons-nous d’âges ou parlons-nous de pouvoir ?
Citant Les Lois de Platon, Moses Finley (« Les personnes âgées dans l’Antiquité classique », Communications 37, 1983, p. 36) rappelle cette formule saisissante qui résonne avec une acuité étonnante face aux problématiques avec lesquelles nous sommes aujourd’hui aux prises : « “L’une des meilleures de vos lois”, déclare le vieil Athénien au vieux Spartiate dans la dernière œuvre de Platon (Les Lois, 643 D), “est l’interdiction absolue faite à tout jeune homme de s’enquérir si l’une quelconque des lois est bonne ou non.” »
Dès lors, une série d’interrogations s’impose, touchant au premier chef celles et ceux qui nous ont précédés : qu’est-ce qu’« être jeune » ou « être vieux » dans les sources de langues grecque et latine ? Ces catégories reposent-elles sur des critères biologiques ou sur des marqueurs sociaux ? Si elles sont opérantes, le sont-elles uniquement pour les mâles citoyens – excluant de fait leurs mères, sœurs, épouses, filles et esclaves ? Interroger les groupes d’âge, c’est alors interroger la manière dont les Anciens pensaient l’ordre social, la hiérarchie des corps et des voix. Partant de là, on peut se demander quelles dissonances et quelles résonnances le monde médiéval entretiendra avec un héritage antique : que conserve‑t‑il, que déplace‑t‑il, que réinvente‑t‑il ?
Les possibilités d’explorer jeunesse et vieillesse sont multiples, tant les sujets se prêtent à des approches variées. Nous souhaitons donc offrir une série de regards croisés afin d’éclairer ces questionnements en mettant en résonance des perspectives contrastées, tant en raison des époques et sociétés étudiées que des sources exploitées ou des méthodes privilégiées. La réflexion doit s’étendre * Augustin d’Hippone, Enarrationes in Psalmos 91.11 (CCSL 39).
1« de la cave au grenier » : antiquisant·es et médiévistes, qu’ils et elles soient philologues, historien·nes ou linguistes, sont donc invité·es à contribuer avec une communication de 20 minutes (+ 10 minutes de questions-réponses) en français ou en anglais.
C’est dans cet esprit que les doctorant·es des services de Langues et littératures grecque et latine de l’Université de Liège ont le plaisir de vous convier à leurs premières journées de rencontres doctorales, les 22 et 23 octobre 2026, ouvertes aux (jeunes) chercheur·euses et doctorant·es désireux·ses d’échanger autour de la réception, de la représentation ou des interactions entre jeunesse et vieillesse dans les sources grecques et latines.
À cette occasion, nous vous invitons à nous soumettre vos contributions qui auront pour orientation les pistes suivantes (sans pour autant vous y contraindre) :
1.Les expressions de la jeunesse et de la vieillesse : quels sont les champs lexicaux spécifiques associés ? Quelles stratégies sont employées pour les décrire de façon indirecte ? Comment leurs représentations révèlent-elles des caractéristiques thématiques et stylistiques de certains auteurs, de certaines œuvres, de certains genres littéraires ?
2.Être jeune ou moins jeune dans les sources écrites : comment les représentations littéraires de la jeunesse et de la vieillesse contribuent-elles à forger des topoi culturels ? Quels rôles jouent les figures animales, mythologiques ou scripturaires dans la construction des images de l’âge ? Comment les sources mettent-elles en scène les rapports entre jeunes et vieux (conflit ; solidarité ; hiérarchie ; différence d’âge dans le mariage) ? En quoi le traitement des âges diffère-t-il selon les genres littéraires (épigrammes et épitaphes ; traités ; genre consolatoire…) ? Comment se négocient les oppositions entre idéalisation de la jeunesse et discours moralisateurs sur la vieillesse ?
3.Univers sociaux et culturels de la jeunesse et de la vieillesse : comment la jeunesse et la vieillesse sont-elles définies et valorisées dans les univers sociaux païens et chrétiens ? Quels rapports entretiennent jeunes et moins jeunes (rituels de passage et transmission symbolique ; pratiques éducatives et pédagogiques ; formes d’autorité et de contestation ; relations affectives et sexuelles ; tensions entre amour et haine ; enjeux de patrimoine matériel et immatériel ; dynamiques familiales et extra-familiale…) ? Comment les cadres législatifs définissent-ils ethiérarchisent-ils les droits et devoirs des individus en fonction de leur âge ?
Afin de prendre part à ces deux jours, nous vous prions de nous transmettre un titre, un résumé (maximum 500 mots) en français ou en anglais et les informations relatives à votre affiliation avant le 30 avril 2026 à l’adresse suivante : mahubert@uliege.be. Merci de faire figurer « [Senecta] » dans l’objet de votre courriel.
Nous vous informerons de votre participation au plus tard le 30 juin 2026.
Au plaisir de faire votre connaissance !
Le comité d’organisation
Pr Pierre Assenmaker (UNamur, professeur – pierre.assenmaker@unamur.be)
Pr Dominique Longrée (ULiège-UCLouvain, professeur ordinaire – dominique.longree@uliege.be)
Pr Nicolas Meunier (UCLouvain, professeur – nicolas.meunier@uclouvain.be)
Marc-Antoine Hubert (ULiège, doctorant – mahubert@uliege.be)
Arianna Rosa (ULiège, aspirante FRS-F.N.R.S. – arianna.rosa@uliege.be)
Hugo Simons (ULiège, assistant – hugo.simons@uliege.be)
Valérie Thon (ULiège-Université Paris Cité, aspirante FRS-F.N.R.S. – valerie.thon@uliege.be)
Le comité scientifique
Dre Sarah Fascione (ULiège, chargée de cours – sara.fascione@uliege.be)
Pr Bruno Rochette (ULiège, professeur ordinaire – bruno.rochette@uliege.be)
Dr Koen Vanhaegendoren (ULiège, chargé de cours – koen.vanhaegendoren@uliege.be)

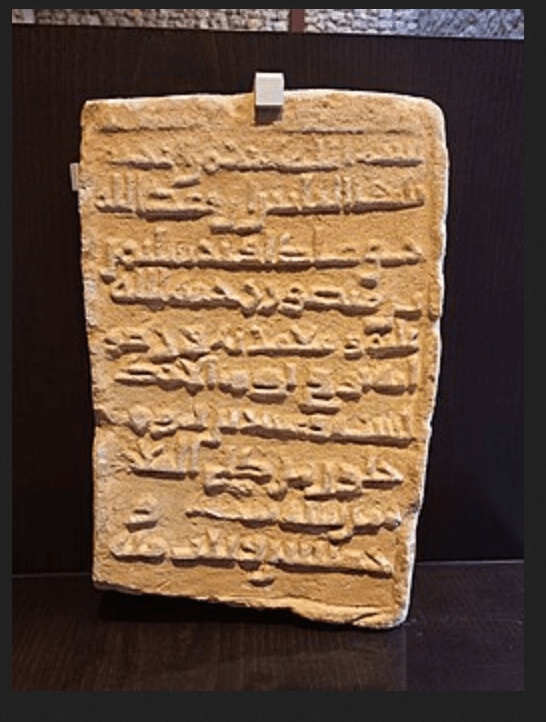
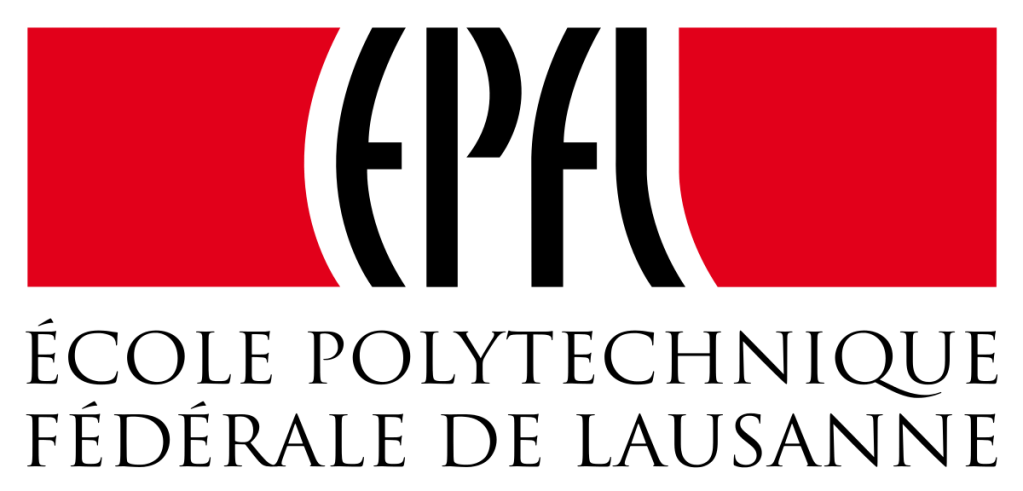

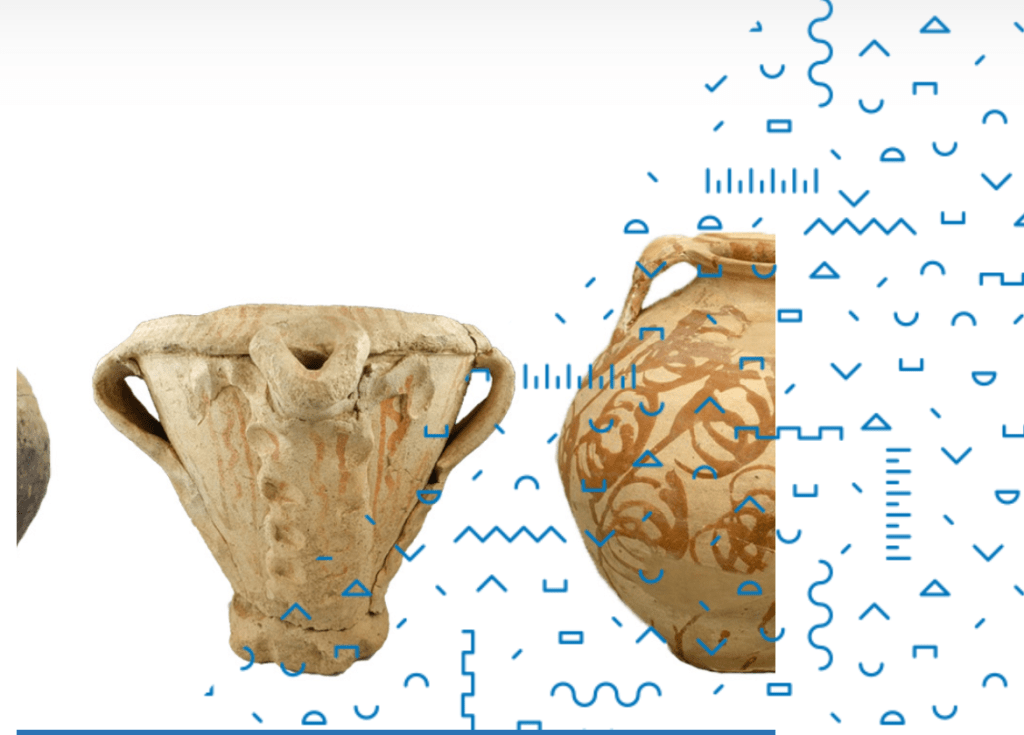
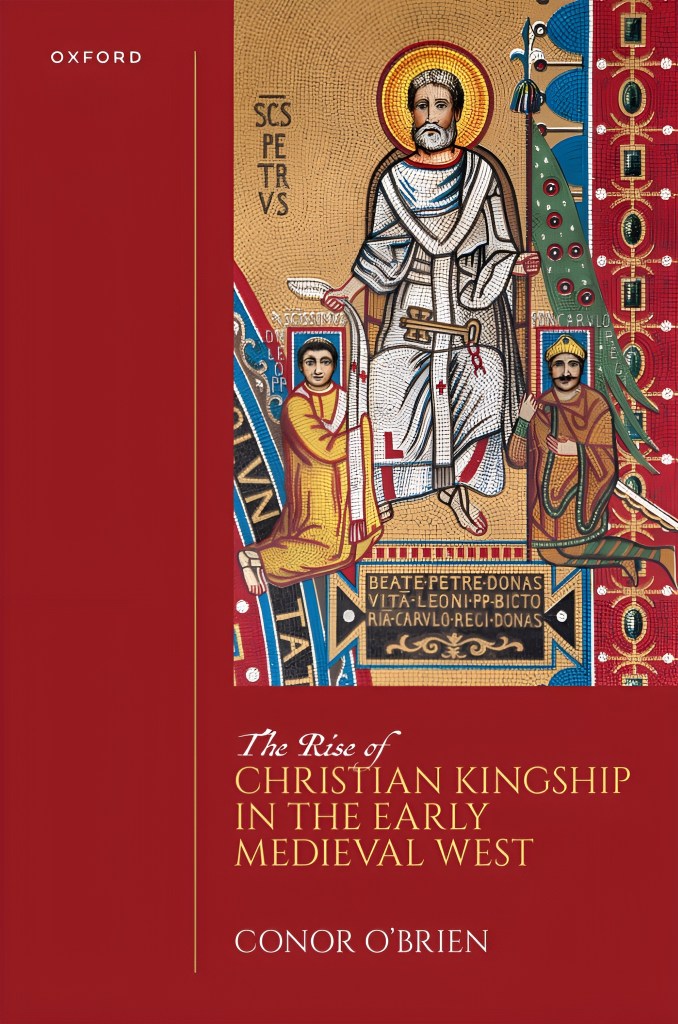


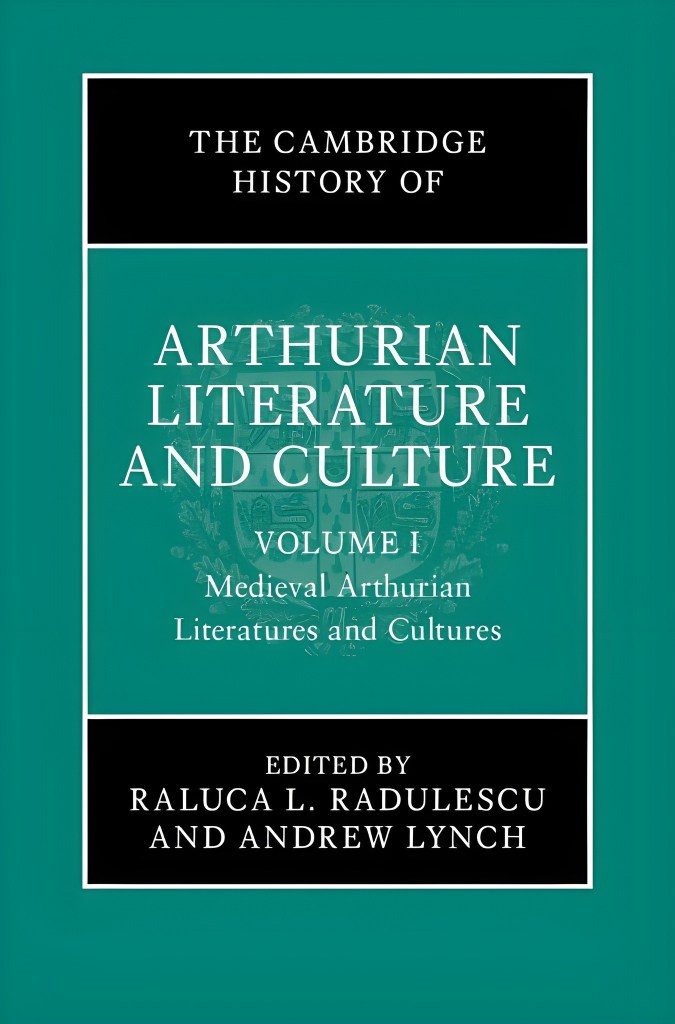






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.